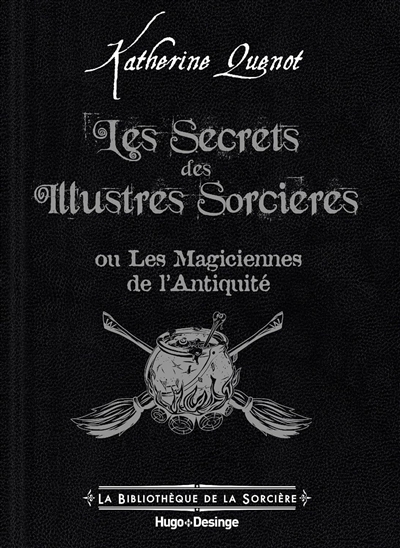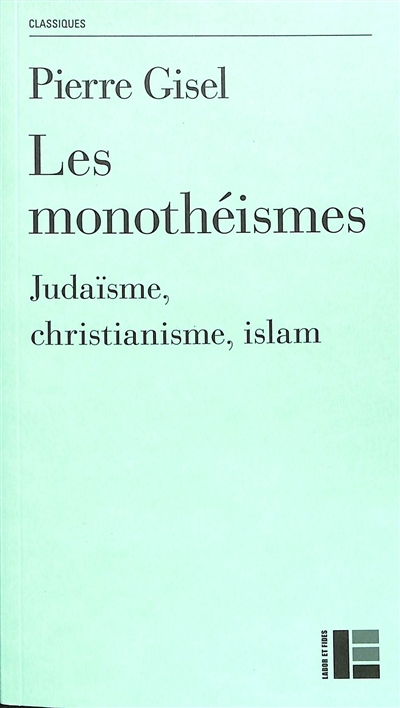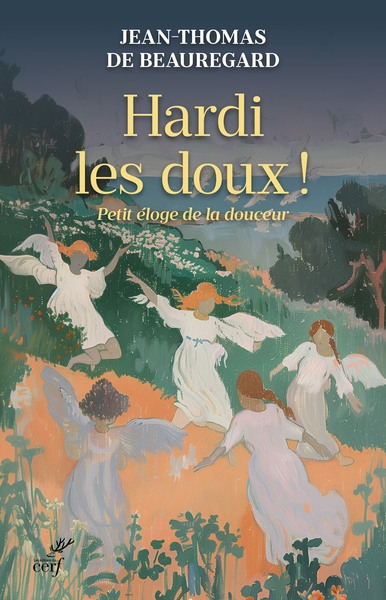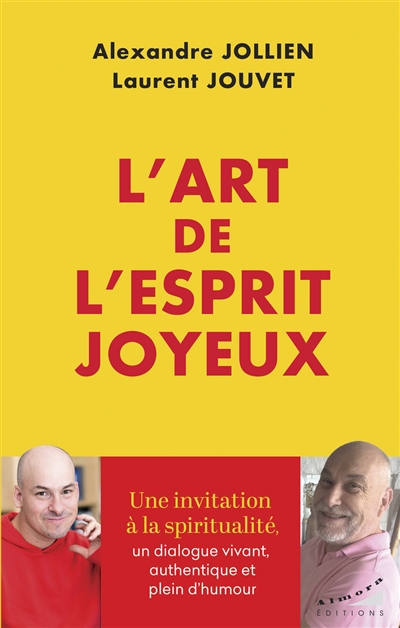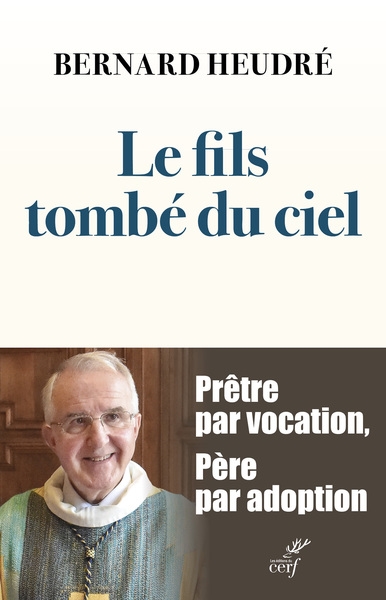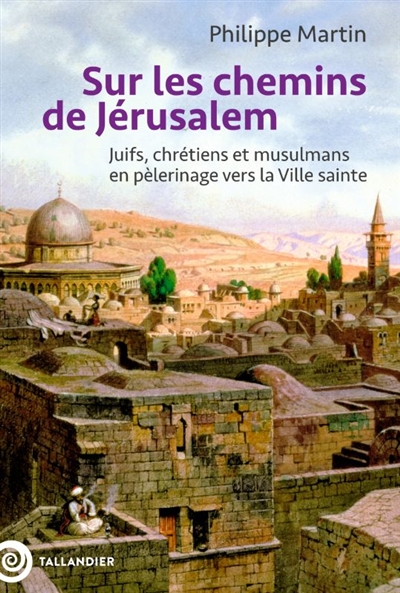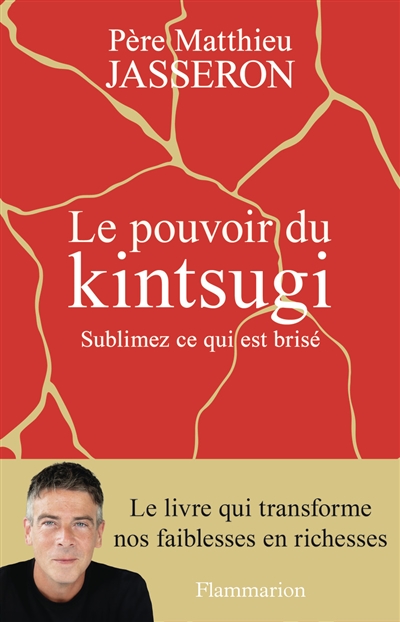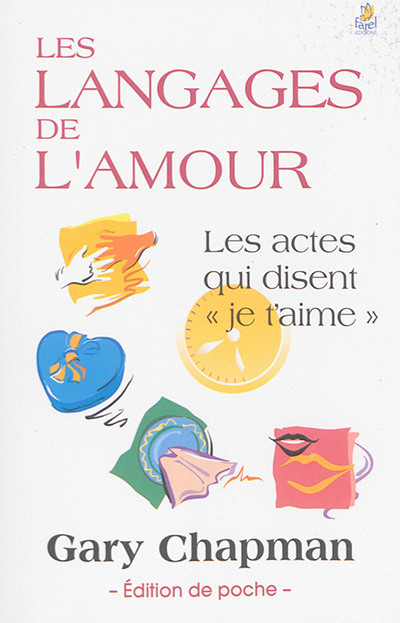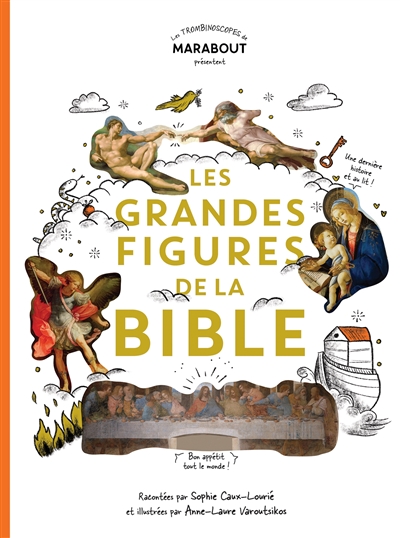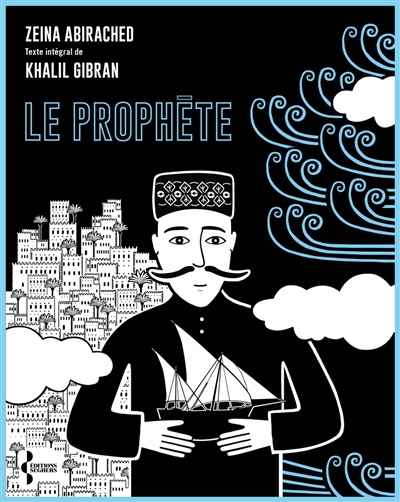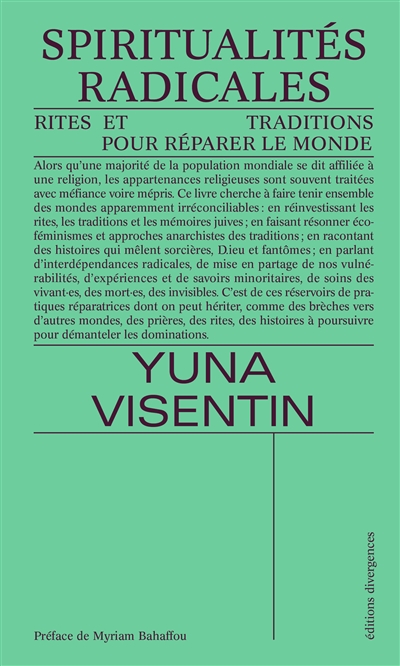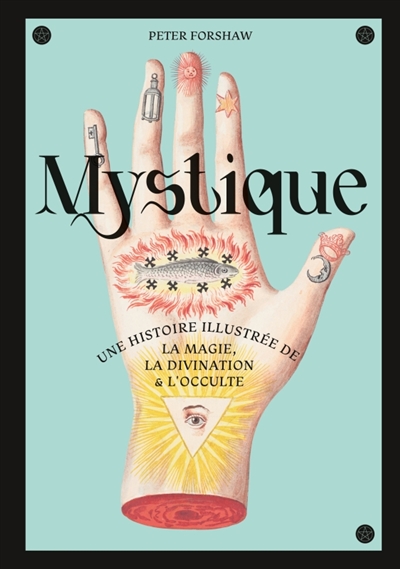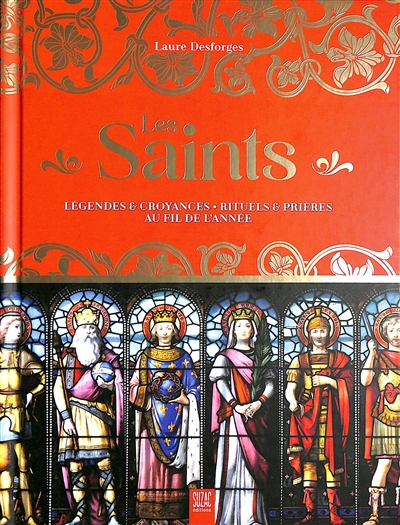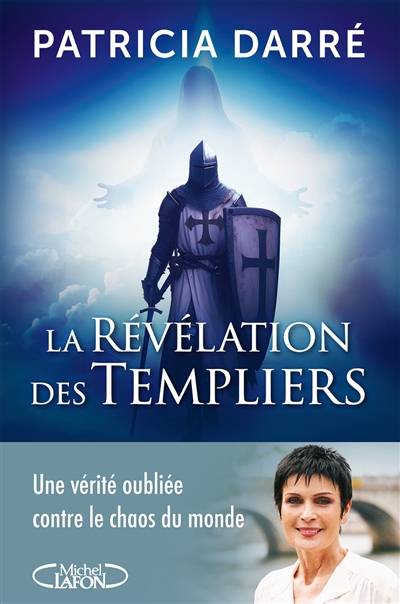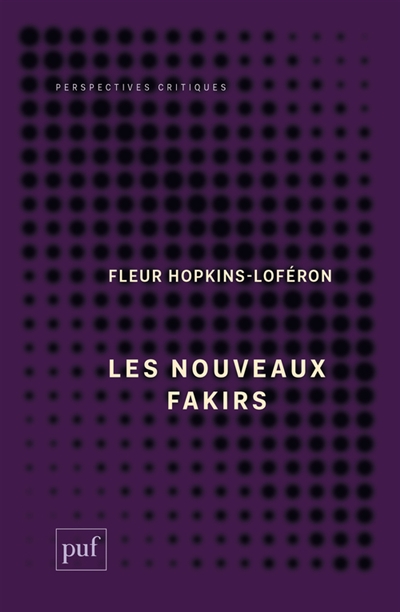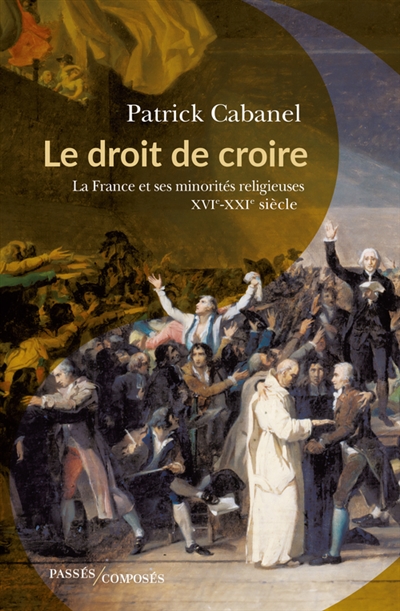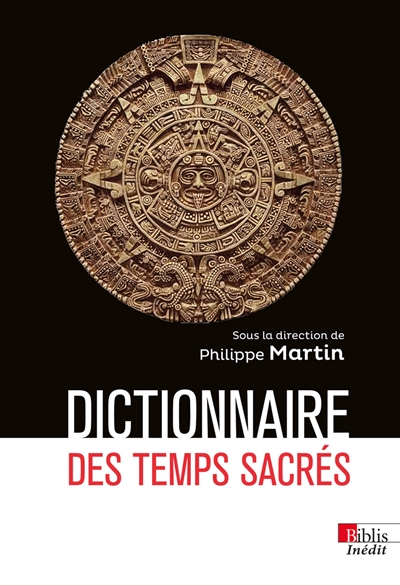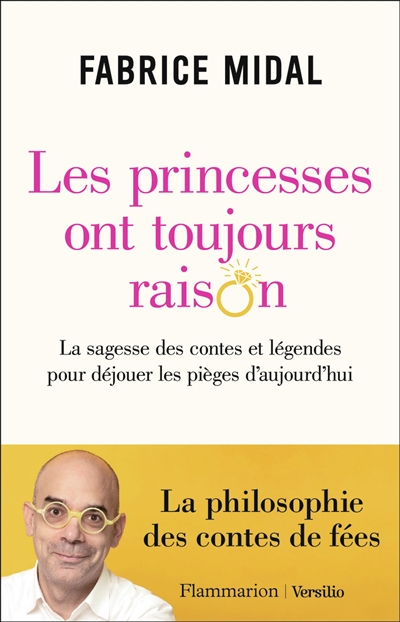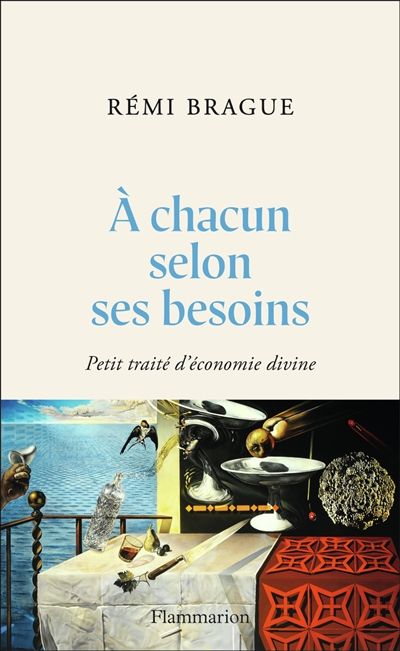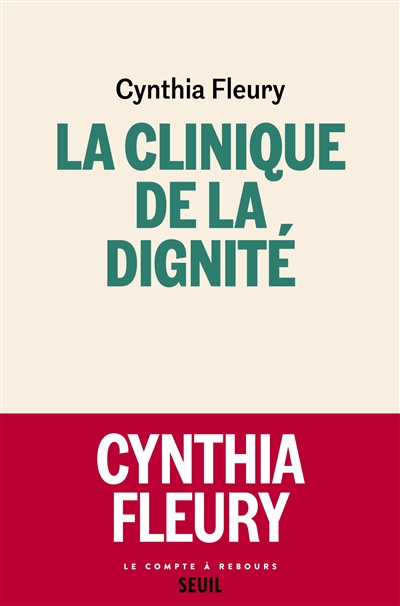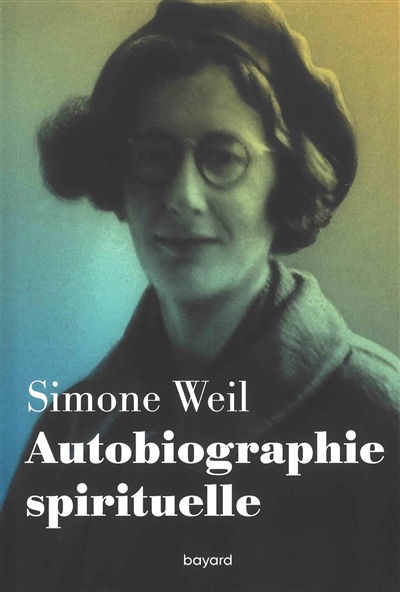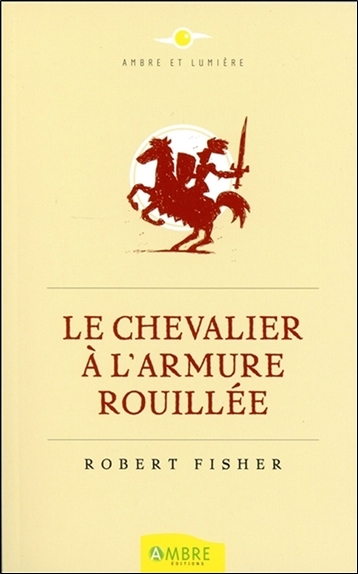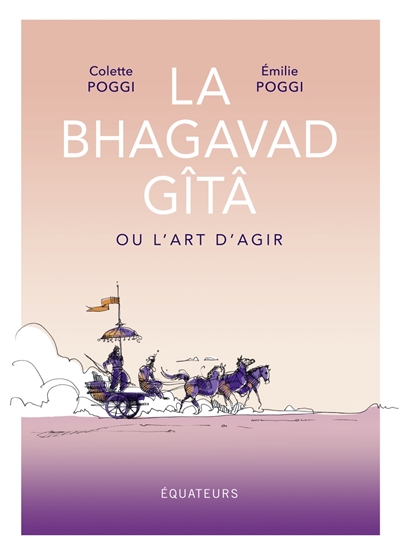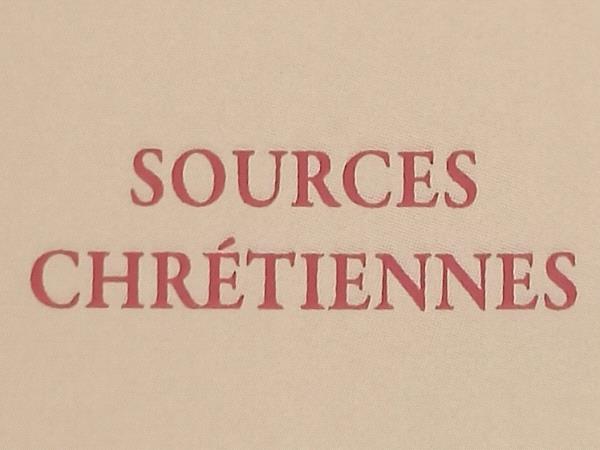Sélections de livres en religion
Les monothéismes : judaïsme, christianisme, islam
Auteur : Pierre Gisel
Éditeur : Labor et Fides
Hardi les doux ! : petit éloge de la douceur
Auteur : Jean-Thomas de Beauregard
Éditeur : Cerf
Le pouvoir du kintsugi : sublimez ce qui est brisé
Auteur : Matthieu Jasseron
Éditeur : Flammarion
Les langages de l'amour : les actes qui disent "je t'aime"
Auteur : Gary D. Chapman
Éditeur : Farel
Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas : à la recherche du royaume
Auteur : Marie Balmary
Éditeur : Albin Michel
Il n'y a pas de Ajar : monologue contre l'identité
Auteur : Delphine Horvilleur
Éditeur : Le Livre de poche
J'ai décidé de vivre : itinéraire d'un orphelin devenu présentateur télé
Auteur : David Milliat
Éditeur : Mon poche
Spiritualités radicales : rites et traditions pour réparer le monde
Auteur : Yuna Visentin
Éditeur : Editions Divergences
Mystique : une histoire illustrée de la magie, de la divination et de l'occulte
Auteur : Peter J. Forshaw
Éditeur : Cernunnos
Yule : la grande fête de l'hiver : célébrez votre premier sabbat
Auteur : Sidonie Dovergne
Éditeur : Secret d'étoiles
Les saints : légendes & croyances : rituels & prières au fil de l'année
Auteur : Laure Desforges
Éditeur : Suzac éditions
La révélation des templiers : une vérité oubliée contre le chaos du monde
Auteur : Patricia Darré
Éditeur : M. Lafon
Coups de cœur
Les nouveaux Fakirs
Le christianisme est un anarchisme, de Jérôme Alexandre.
Que nenni, défend Jérôme Alexandre pour qui ce serait avant tout une question de réputation. À rebours du portrait défaitiste que l’on serait tenté de brosser de l’un comme de l’autre, le théologien pose à nouveau les fondements d’un dialogue entre anarchisme et christianisme non seulement possible, mais encore souhaitable. Délaissant les débats de doctrines et d’idées, l’auteur propose de rapprocher histoires, mémoires collectives, valeurs et perspectives. Une forme de protestation, un défi qui consiste à se réinventer sans cesse serait le terreau fertile d’une entente mutuellement bénéfique.
Si ces affinités ne sont pas neuves - le courant anarchiste chrétien les a après tout déjà portées aux XIXème et XXème siècles par l’intermédiaire de grandes voix telles que celles de Jacques Ellul, Ivan Illich ou encore Simone Weil -, Jérôme Alexandre dépoussière nos grilles de lecture, en bouleverse les idées reçues et met à bas les raccourcis trop faciles. Un essai salutaire à travers lequel tout chrétien peut trouver à dépasser la tendance au repli identitaire ou victimaire et renouer avec l’essence du christianisme en tant que manière d’être au monde.
"Le droit de croire" ou la difficile construction du pluralisme religieux en France
Le droit de croire : la France et ses minorités religieuses : XVIe-XXIe siècle
Auteur : Patrick Cabanel
Éditeur : Passés composés
Les origines du sacré
"Savez-vous où je pourrais acheter un vrai dieu ?"
À le lire, on croirait qu’il se lance dans ces expériences à grande échelle la fleur au fusil, presque comme s’il se retrouvait là un peu par hasard. Il y a dans la façon dont il livre ses observations, évoque ses impressions et pose ses questions une ingénuité que l’ampleur de son enquête rend désarmante. Ainsi, en toute simplicité (du moins le croit-on…), il part en Inde demander à qui voudra bien lui apporter une réponse s’il est possible d’acheter un dieu.
La question fait d’abord sourire. Il finira pourtant par créer une véritable religion dont le lancement officiel se fera au cœur de New York, sur la place la plus populaire de Manhattan. Mais le journaliste cash ne se laissera pas dire que son livre est une satire de la religion, lui qu’un vide spirituel pousse finalement à partir mener cette nouvelle enquête. Entre l'innocente question et un lancement en grandes pompes à Time Square, Juan Pablo Meneses va interroger profondément notre rapport à la foi — la sienne comme la nôtre — et la façon dont la surconsommation en altère l'essence, exposant une fois de plus les affres d’un business très lucratif, celui des croyances.
La genèse de la religion itinérante (ainsi que l'éventuelle épiphanie de son prophète) est à découvrir dans son livre sacré, bien évidemment disponible à la vente, à travers le récit aussi drôle que passionnant de cette improbable aventure. La boucle est bouclée !
Dictionnaire des temps sacrés
Un ouvrage pertinent, complet et acessible pour tout lecteur s'intéressant aux faits religieux.
Les princesses ont toujours raison
À chacun selon ses besoins - Rémi Brague
A chacun selon ses besoins : petit traité d'économie divine
Auteur : Rémi Brague
Éditeur : Flammarion
La clinique de la dignité - Cynthia Fleury
Simone Weil, philosophe au seuil de l’Église
Science et foi : un dialogue salutaire plutôt qu'une guerre de tranchées
La science, l'épreuve de Dieu ? : réponses au livre Dieu, la science, les preuves
Auteur : François Euvé
Éditeur : Salvator
Un conte initiatique plein d’humour et de sagesse
Le repos est une affaire sérieuse
Vivre avec nos morts - Delphine Horvilleur
Du drame des attentats de Charlie Hebdo à l'organisation de funérailles pour ses fidèles, en passant par le souvenir de la Shoah, ce livre est un vrai moment de grâce, ainsi qu'un formidable hymne à la vie, qui mêle l'humour à la sensibilité.